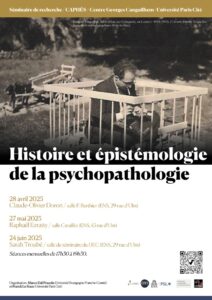Séminaire « Histoire et épistémologie de la psychopathologie »
Le CAPHÉS, le Centre Georges Canguilhem et l’Université Paris Cité proposent le séminaire de recherche « Histoire et épistémologie de la psychopathologie » (Histépsy) organisé par Marco Dal Pozzolo (Dr, Université Bourgogne-Europe, LIR3S) et Franck Le Roux (Dr, Université Paris Cité, CRPMS)
Année 2025 – 1ère saison
Argument général :
Le séminaire Histoire et épistémologie de la psychopathologie se propose d’analyser et de discuter les concepts des « psychopathologies » en prenant en compte leur circulation entre les différentes disciplines « psy ». Ce séminaire s’inscrit dans le sillage de la philosophie de Georges Canguilhem, dans un double sens.
Il s’inspire en premier lieu de l’histoire critique des concepts, poursuivant l’intuition que le domaine spécifique de l’histoire des sciences concerne « des concepts à analyser et à critiquer ». En se distinguant à la fois d’une généalogie sémantique et d’une analyse des théories scientifiques, l’histoire des concepts psychopathologiques est proposée dans le cadre de ce séminaire comme une perspective permettant de retracer les déplacements de concepts entre les frontières disciplinaires et d’examiner de façon normative leurs valeurs pratiques et cliniques. De ce point de vue, le travail historique de ce séminaire se constituera en lien étroit avec une critique des concepts comme caractéristique fondamentale de l’épistémologie historique.
Dans un deuxième sens, notre séminaire propose d’aborder les catégories psychopathologiques au prisme de la philosophie de la santé et du pathologique, élaborée par Georges Canguilhem à partir de 1943. En lien étroit avec la théorie clinique de Kurt Goldstein, la pensée de Canguilhem permet notamment de penser la psychopathologie à partir de la relation entre organisme, norme et milieu. Pour se limiter à quelques exemples, des cas d’anxiété généralisée ou d’agoraphobie peuvent être interprétés dans ce cadre comme des formes de rétrécissement du milieu de vie du malade; de même, le “syndrome de Diogène” peut être lu comme la construction d’un milieu adapté aux exigences de l’individu, lui permettant de maintenir un comportement ordonné.
Loin d’être le périmètre exclusif du séminaire, l’inspiration canguilhemienne est censée dialoguer dans ce cadre avec d’autres perspectives philosophiques, historiques et cliniques portant sur les concepts psychopathologiques. À côté des interventions centrées sur l’histoire des concepts et leurs usages contemporains, nous nous concentrerons spécialement sur les axes suivants.
Axes de recherche :
I) Canguilhem et la psychopathologie
Nous explorerons les relations historiques et conceptuelles entre la trajectoire philosophique de Canguilhem et un ensemble d’auteurs et de courants ayant marqué l’histoire de la psychopathologie, à commencer par les psychiatres qui ont explicitement influencé l’Essai de 1943 (Lagache, Blondel, Minkowski, Jaspers, Ey et Rouart). Nous pourrons pousser plus loin cette étude en nous intéressant également aux relations de Canguilhem avec F. Tosquelles, L. Bonnafé, G. Lanteri-Laura et le “premier” Lacan (de la thèse de 1933). Plus généralement, un de nos objectifs sera d’approfondir les usages et la référence commune à K. Goldstein entre Canguilhem et la nouvelle génération des “jeunes psychiatres” réunis autour de la revue de l’Évolution psychiatrique au cours des années quarante et cinquante en France.
II) Psychopathologie et histoire de la philosophie
Le séminaire abordera également les relations entre catégories psychopathologiques et histoire de la philosophie. Il sera l’occasion de réfléchir sur le regard et les usages que certains philosophes ont pu faire de notions psychopathologiques. À titre d’exemple, les écrits de Kierkegaard et d’Heidegger sur l’angoisse pourront être discutés, ainsi que la « fatigue profonde » dont parle Nietzsche dans ses Fragments posthumes. Les réflexions de Merleau-Ponty sur des cas de pathologies neuropsychologiques pourront également être examinées ainsi que les relations entre l’École de Francfort et la psychanalyse. Nous pourrons également explorer les propositions théoriques de philosophes vivants, tout en gardant une attention au contexte d’émergence disciplinaire, pratique et théorique des concepts en question.
III) Psychopathologie du travail
Nous discuterons également de différentes perspectives au sein de la psychopathologie du travail. Nous pourrons analyser les intersections entre l’ergologie d’Yves Schwartz et la santé au travail, en continuité avec la philosophie canguilhemienne. Nous pourrons également approfondir la clinique de l’activité d’Yves Clot et ses concepts caractéristiques, tels que ceux de “pouvoir d’agir” ou d’“activité empêchée”. Le séminaire pourra également être l’occasion d’évaluer les croisements et les divergences que ces approches entretiennent avec la psychodynamique du travail de Christophe Dejours.
IV) Psychopathologie et sciences cognitives
Nous nous proposons également d’explorer les relations contemporaines entre psychopathologie et sciences cognitives qui se développent aujourd’hui sous l’appellation de “psychopathologie cognitive”, depuis, en particulier, une application du concept de “cognition sociale” à un ensemble de situations pathologiques (la schizophrénie par exemple). Cet axe aura plus spécifiquement pour but de procéder à un examen épistémologique des concepts émergents en psychopathologie et des propositions thérapeutiques qui leurs sont cohérentes (la “réhabilitation psychosociale” par exemple, ou le concept de “psychose émergente”). Nous pourrons également approfondir dans ce cadre l’examen de quelques recherches actuelles de psychiatrie biologique (neurosciences, génétique, psychiatrie de précision) et leurs perspectives thérapeutiques.
V) Psychopathologie et politique publique
Nous nous proposons d’aborder également les problèmes et relations actuelles entre psychopathologie et santé publique à commencer par le discours actuel de “déstigmatisation” des maladies mentales, le concept de “démocratie sanitaire” appliqué à la psychiatrie, l’implication grandissante des “associations de patients” dans la conception des soins et des maladies psychiatriques, le développement de la “paire-aidance”, la place actuelle des “juges des libertés” ainsi que le problème de l’augmentation des soins dits “intensifs” d’isolement et de contention. Le but sera d’étudier les relations actuelles entre “psychiatrie universitaire” et “psychiatrie ordinaire” sur le problème des rapports entre soin et liberté publique ; en particulier, le positionnement actuel de la première qui se veut original et progressiste sur ce point à travers tout un ensemble de propositions de réorganisation pratique et discursive. Le but sera d’étudier les relations entre discours, concepts et politiques publiques dans la réorganisation des soins et des concepts en santé mentale aujourd’hui. Nous pourrons dans ce cadre analyser un certain nombre de propositions qui se sont pensées historiquement comme des alternatives organisationnelles (antipsychiatrie anglaise et italienne, psychothérapie institutionnelle, psychiatrie de secteur) en analysant leurs relations avec les politiques publiques actuelles.
Programme
1ère séance : Lundi 28 avril 2025, de 17h30 à 19h30.
- Claude-Olivier Doron (Université Paris Cité, SPHÈRE) : La santé mentale : généalogie et perspectives critiques autour d’un signifiant flottant
Bâtiment Jaurès (29 rue d’Ulm), Salle Ferdinand Berthier (2ème étage).
2ème séance :Mardi 27 mai 2025, de 17h30 à 19h30.
- Raphaël Ezratty (Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations, INSERM-Université Paris Saclay) : Hikikomori : histoire et clinique d’un rétrécissement du milieu de vie
Bâtiment Ulm (45 rue d’Ulm), Salle Cavaillès (1er étage).
3ème séance : Mardi 24 juin 2025, de 17h30 à 19h30.
- Sarah Troubé (Université Paris Cité, CRPMS) : L’expérience de la psychose débutante : psychanalyse, phénoménologie et neurocognition
Bâtiment Jaurès (29), Salle Séminaire du DEC (RDC).